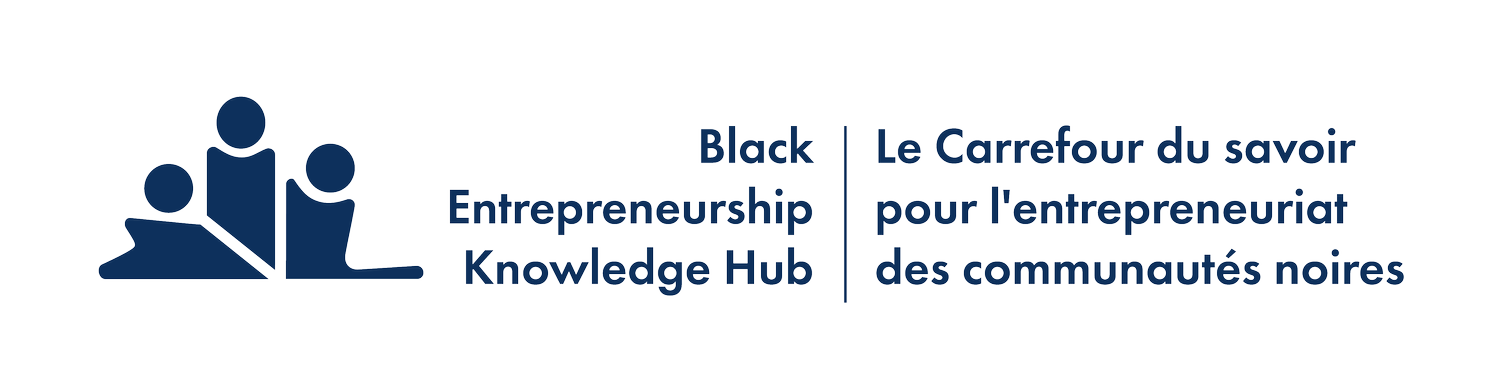Franchir une double barrière : comment les entrepreneurs noirs du Québec réécrivent les règles de la réussite
L’arôme d’un ragoût mijoté et le rêve d’un sentiment de fierté culturelle ont nourri le parcours de Mariam vers l’ouverture de l’un des premiers restaurants congolais à Montréal. « Je ne me suis pas demandé s’il y avait suffisamment de clients congolais. Je voulais partager ma culture », se souvient-elle. Mais sans accès à un financement traditionnel ni à un vaste réseau d’affaires, Mariam a dû compter sur ses économies personnelles et sur le soutien de sa communauté — une réalité vécue par de nombreux entrepreneurs noirs à travers le Québec.
L’entrepreneuriat promet l’indépendance, mais pour les propriétaires d’entreprises noirs au Québec, il exige souvent de naviguer dans un environnement façonné par les lois linguistiques, les nuances culturelles et les barrières systémiques. Une nouvelle étude menée par le Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat des communautés noires (CSEN), en partenariat avec le Provincial Employment Roundtable (PERT), offre un premier regard approfondi sur ces défis imbriqués — et sur les stratégies résilientes que les entrepreneurs noirs du Québec mettent en œuvre pour prospérer.
Dirigé par Dave Mckenzie et Sta Kuzviwanza, cochercheurs principaux, le projet visait à mettre en lumière les réalités propres à l’entrepreneuriat noir dans une province où l’identité et les occasions sont étroitement liées à la langue et à l’histoire. « Le parcours entrepreneurial des Québécois noirs est façonné non seulement par l’ambition, mais aussi par la nécessité de surmonter des obstacles systémiques — à la fois raciaux et linguistiques », explique M. Mckenzie
Alors que les entreprises appartenant à des Noirs représentent environ 2,1 % de l’ensemble des entreprises au pays, au Québec, l’intersection de la race, de la langue et de l’économie rend le paysage encore plus complexe. En moyenne, les Québécois noirs gagnent 8 000 $ de moins que les minorités non visibles dans la province et connaissent des taux de chômage plus élevés — des statistiques qui témoignent d’inégalités systémiques.
Dans l’environnement linguistique particulier du Québec, ces défis sont amplifiés. Des entrepreneurs comme Ibrahim, fondateur d’une entreprise technologique à Montréal, expliquent : « C’est comme repartir de zéro. Pas de patrimoine familial, pas de réseaux, aucun actif pour garantir un prêt — et si vous êtes anglophone, vous vous heurtez à un autre mur. » Les recherches nationales existantes passent souvent sous silence la façon dont la politique linguistique, les particularités culturelles et les réalités démographiques façonnent l’écosystème entrepreneurial au Québec. Cette nouvelle étude constitue un rare effort pour saisir cette nuance.
Pour bien comprendre la situation, les chercheurs ont mené des entrevues et des groupes de discussion avec 30 entrepreneurs noirs de partout au Québec, complétés par les observations de cinq experts du domaine. Ces témoignages ont été appuyés par les données de l’étude quantitative nationale du CSEN, qui a sondé 2 381 entrepreneurs noirs à l’échelle du pays — dont 460 provenant du Québec.
La recherche a permis d’identifier six thèmes essentiels qui définissent l’expérience entrepreneuriale des Québécois noirs :
Accès au capital : De nombreux entrepreneurs sont exclus des voies de financement traditionnelles et doivent plutôt compter sur leurs économies personnelles ou sur leurs réseaux communautaires.
Orientation communautaire : Les entreprises desservent souvent des communautés culturelles ou linguistiques précises, ce qui limite l’accès à des marchés plus larges.
Barrières linguistiques : Les entrepreneurs non francophones subissent une « double minorisation » — marginalisés à la fois par la race et par la langue.
Défis liés au réseautage : L’accès limité aux réseaux d’affaires grand public du Québec oblige les entrepreneurs à miser sur la promotion de proximité.
Dynamiques de genre : Les entrepreneures noires sont soumises à une surveillance accrue et doivent souvent concilier les exigences de leur entreprise avec leurs responsabilités familiales.
Modèles d’affaires informels : Les entreprises à domicile et les modèles flexibles sont fréquents en raison des coûts de démarrage élevés et du soutien institutionnel limité.
« Il ne s’agit pas seulement d’argent; il s’agit d’accéder à des réseaux, à des connaissances, à un sentiment d’appartenance », affirme Mme Kuzviwanza. Pour Sarah, qui exploite un salon de coiffure à domicile à Laval, démarrer de façon informelle était la seule voie possible : « Sans options de financement traditionnelles, j’ai commencé dans mon salon, un client à la fois. »
Les entrepreneurs noirs du Québec font preuve d’une résilience remarquable, misant sur des liens communautaires étroits et des réseaux de proximité pour maintenir et faire croître leurs entreprises. Toutefois, la recherche souligne que ces stratégies informelles, bien que créatives, sont souvent dictées par la nécessité — une réponse aux obstacles créés par les inégalités systémiques et les dynamiques linguistiques propres au Québec. « Chaque nouveau client est la preuve que nous pouvons bâtir quelque chose de durable, même si nous partons de rien », confie un entrepreneur de Montréal.
Cependant, la seule dépendance envers la communauté ne suffit pas à assurer une croissance durable dans le marché concurrentiel du Québec, ce qui met en lumière la nécessité de réformes systémiques.
Financée par le Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat des communautés noires (CSEN), cette étude ne vise pas uniquement à décrire ces défis, mais aussi à susciter un changement concret dans le contexte unique du Québec. « Notre objectif est d’aller au-delà du simple constat des disparités — nous voulons inciter à l’action pour bâtir un écosystème entrepreneurial bilingue et plus inclusif », souligne M. Mckenzie.
Parmi les recommandations issues de la recherche figurent la révision des critères d’admissibilité aux programmes de financement, l’élargissement des possibilités de mentorat et de formation en affaires bilingues, ainsi que la sensibilisation accrue du marché à la valeur que les entreprises appartenant à des Noirs apportent à l’économie québécoise. Soutenir les entrepreneurs noirs n’est pas seulement une question d’équité — c’est aussi une question d’avenir économique pour le Québec. Les entreprises diversifiées stimulent l’innovation et renforcent la résilience, deux atouts dont le Québec aura de plus en plus besoin.
Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la Conférence de synthèse 2025, où des décideurs, des entrepreneurs et des leaders communautaires se sont réunis pour discuter de l’avenir de l’entrepreneuriat noir au Québec. L’élan donné par la conférence alimente désormais les efforts en cours visant à transformer les constats en politiques concrètes et en améliorations de l’écosystème. « Si nous soutenons la personne derrière l’entreprise, nous soutenons l’avenir même de l’entrepreneuriat », affirme Mme Kuzviwanza.