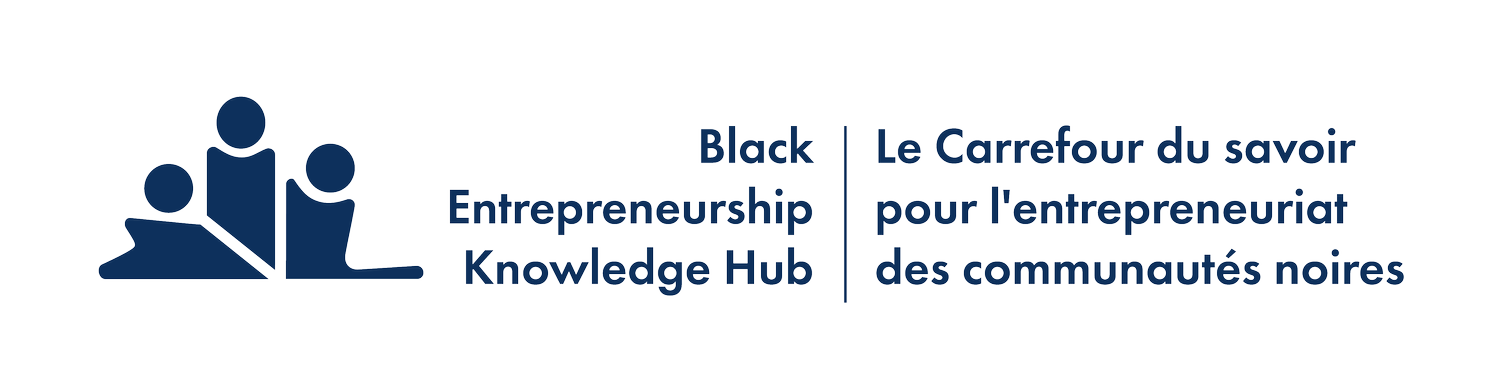Atlantique noir : bâtir la recherche sur l’entrepreneuriat à partir de la base
Que faut-il pour mettre sur pied un centre de recherche sur l’entrepreneuriat noir dans la région de l’Atlantique, un territoire où les ressources universitaires sont limitées et où les communautés noires sont souvent négligées? Pour le professeur Harvi Millar et son équipe de l’Université Saint Mary’s, il a fallu de la persévérance, de solides partenariats et un engagement indéfectible envers la recherche axée sur la communauté.
Lorsque le Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat des communautés noires (CSEN) a lancé ses appels pour établir des carrefours régionaux à travers le pays, l’Université Saint Mary’s ne faisait pas partie des premières sélections. Toutefois, grâce à une relation déjà établie avec le Black Business Initiative (BBI) et à un historique de projets centrés sur la communauté, l’équipe du professeur Millar était bien positionnée lorsque l’occasion s’est présentée d’ancrer le carrefour atlantique.
« Nous savions qu’il existait des lacunes en matière de recherche qui ne pouvaient pas être comblées à distance, explique M. Millar. Si nous voulons comprendre les véritables obstacles et occasions pour les entrepreneurs noirs ici, nous devons bâtir ce savoir au sein même de la communauté. »
En réunissant un petit groupe de professeurs de l’Université Saint Mary’s et de l’Université Dalhousie, ainsi que des doctorants originaires de Tanzanie et du Kenya, le carrefour atlantique s’est rapidement mis au travail. Il est apparu clairement dès le départ que la région comptait peu de chercheurs dont l’expertise principale portait sur l’entrepreneuriat — et encore moins sur l’entrepreneuriat noir. Cette contrainte ne les a pas freinés; ils ont plutôt misé sur la constitution d’une équipe motivée à explorer des questions négligées et résolue à donner un sens concret et local à ses travaux.
Alors que l’entrepreneuriat noir a gagné en visibilité dans des provinces comme l’Ontario et l’Alberta, le Canada atlantique demeure sous-représenté dans les études nationales. En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les entreprises appartenant à des Noirs évoluent souvent dans de plus petits marchés disposant de réseaux de soutien moins développés, et la recherche a largement ignoré leurs réalités particulières.
À l’échelle nationale, les études démontrent que les femmes noires constituent le groupe d’entrepreneures dont la croissance est la plus rapide. Pourtant, dans la région de l’Atlantique, les défis sont amplifiés : un accès réduit au capital, un nombre limité de possibilités de mentorat et des obstacles systémiques persistants demeurent des réalités constantes. « Nous devions documenter ces expériences de façon rigoureuse, explique M. Millar, non seulement pour produire un rapport, mais aussi pour commencer à bâtir une base plus solide en vue de futures recherches menées par des chercheurs noirs dans la région. »
Le carrefour atlantique a structuré son travail autour de trois études principales. La première porte sur les femmes entrepreneures noires en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, en examinant comment leurs passions personnelles s’entrecroisent avec les obstacles systémiques pour façonner leurs parcours entrepreneuriaux. Les résultats préliminaires indiquent que, si la plupart des femmes lancent leur entreprise pour réaliser un rêve de longue date ou répondre aux besoins de leur communauté, elles se heurtent à un accès limité au financement, à une faible utilisation des outils numériques et au poids persistant des préjugés raciaux et sexistes.
Le deuxième projet, dirigé par le doctorant Prince Foya, examine les expériences des entrepreneurs noirs autochtones — comme les Néo-Écossais d’origine africaine — comparées à celles des entrepreneurs noirs immigrants. Bien que les deux groupes se heurtent à des obstacles systémiques similaires, les données préliminaires révèlent des distinctions importantes : les entrepreneurs immigrants mentionnent plus souvent leur manque de familiarité avec le marché local et les difficultés à accéder au capital, tandis que les communautés noires établies de longue date expriment une frustration plus profonde face à l’exclusion persistante et au soutien limité des réseaux existants.
La troisième étude s’intéresse aux types d’entreprises que choisissent de lancer les entrepreneurs noirs — et aux raisons de ces choix. Elle confirme une tendance observée à l’échelle nationale : les entreprises appartenant à des Noirs sont surreprésentées dans des secteurs à faible croissance, comme la restauration et le commerce de détail, et sous-représentées dans des secteurs à forte croissance, tels que les technologies de l’information, les énergies renouvelables et la fabrication. Les causes sont multiples — allant du manque d’accès au financement au racisme systémique dans certaines industries —, mais le constat est clair : les obstacles systémiques influencent les choix entrepreneuriaux d’une manière qui limite l’accumulation de richesse à long terme.
Bien que le carrefour atlantique ait dû composer avec des défis liés à la mobilisation de la capacité de recherche, il a trouvé sa force dans les partenariats. Des organisations comme le Black Business Initiative, Black Women in Excellence, Tribe Network et le Black Business Professional Network du Nouveau-Brunswick ont apporté un soutien essentiel — en facilitant la collecte de données et en mettant les chercheurs en relation avec des entrepreneurs partout dans la région.
« Ces partenariats ont été déterminants, affirme M. Millar. Ce sont des organisations crédibles au sein de la communauté, et elles nous ont aidés à bâtir notre crédibilité et à nous assurer que notre recherche reflète des voix et des expériences réelles. »
Le carrefour atlantique prévoit de soumettre ses rapports de recherche au CSEN d’ici le début de 2025, dans l’optique de traduire les résultats en publications universitaires et en recommandations stratégiques. M. Millar se montre optimiste quant à l’impact que ce travail pourra avoir — non seulement dans la région de l’Atlantique, mais aussi dans la manière de repenser la recherche sur l’entrepreneuriat noir à l’échelle nationale.
« Le véritable succès de ce travail ne se mesurera pas au nombre de pages d’un rapport, affirme-t-il. Il se mesurera à notre capacité à contribuer à un changement — un changement où un plus grand nombre d’entrepreneurs noirs se sentiront vus, où davantage de chercheurs s’empareront de ces questions avec sérieux, et où la prochaine génération disposera d’une base solide sur laquelle bâtir. »
Pour l’équipe du carrefour atlantique, ce travail ne représente pas une fin, mais un commencement. Forte de nouvelles relations et d’une compréhension plus claire des besoins régionaux, elle réfléchit déjà à la suite : élargir son réseau de recherche, encadrer de nouveaux chercheurs et militer pour un écosystème de l’entrepreneuriat noir plus inclusif et fondé sur des données probantes.