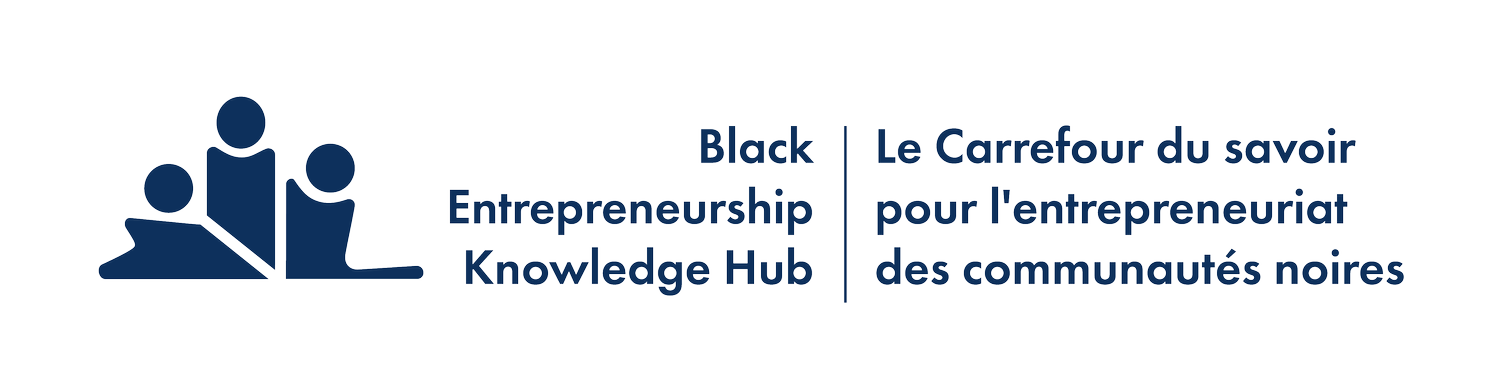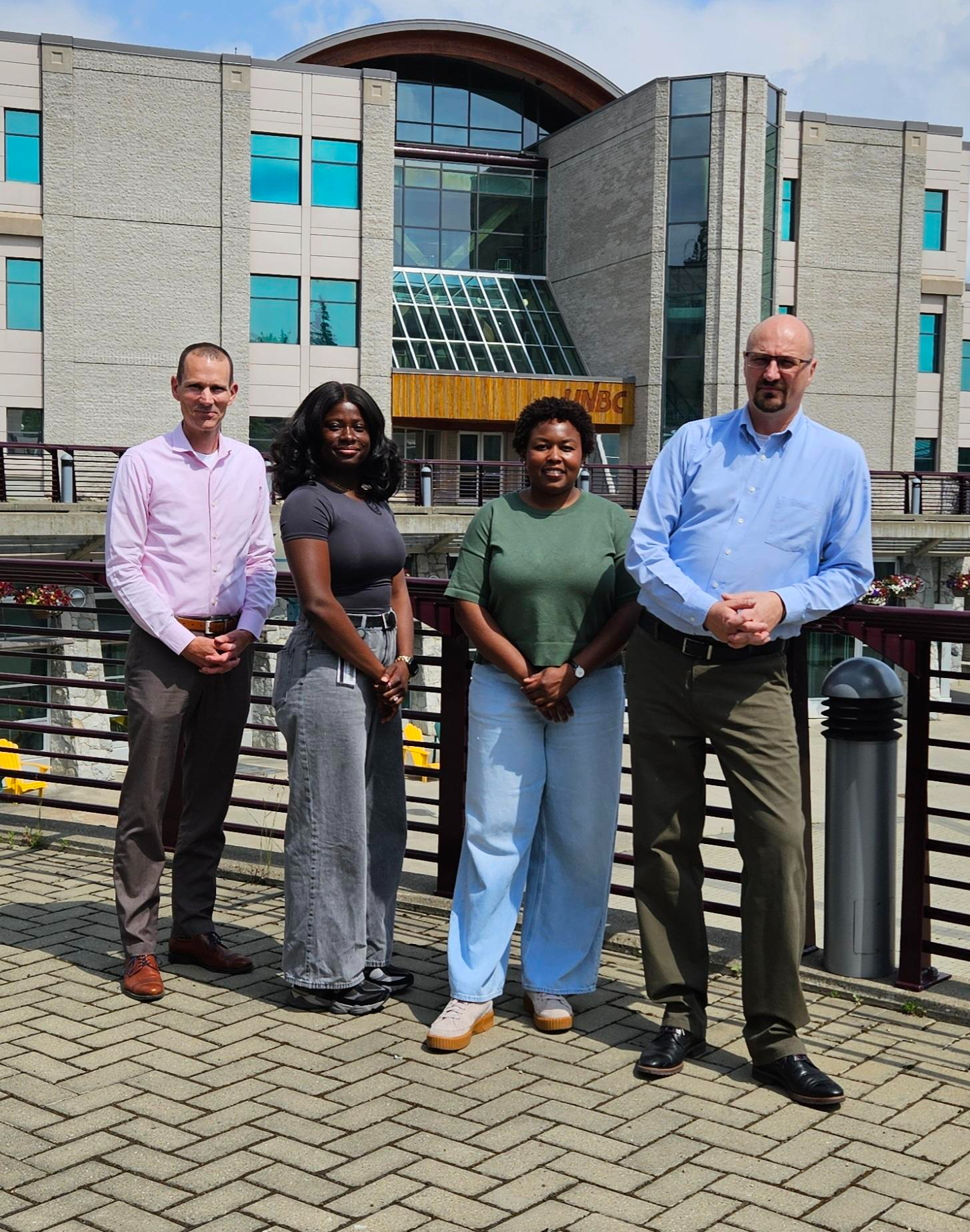Le coût de la distance : financement, sentiment d’appartenance et entreprises noires dans le Nord
Équipe d’entrepreneuriat de l’UNBC (de gauche à droite) :
Richard McAloney, Cynthia Williams, Tracy Hall, and Fryderyk Paczkowski.
L’entrepreneuriat dans le Nord canadien comporte un coût particulier : celui de la distance. Pour les entrepreneurs noirs, les réalités géographiques se heurtent aux obstacles liés au financement, à la confiance fragilisée envers les institutions et à la difficulté constante de se sentir pleinement inclus dans la conversation nationale sur le soutien aux entreprises.
Pour Tracy Hall, qui a travaillé comme associée de recherche auprès du carrefour régional nord du CSEN à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC), le défi était clair dès le départ. « La région nordique est un peu différente du reste du pays en raison de son immensité, se rappelle-t-elle. Ce n’est pas aussi simple que d’organiser un événement et de rassembler les gens. La géographie et les coûts de déplacement rendent déjà la chose difficile, et lorsqu’on ajoute à cela des feux de forêt ou des évacuations, tout est bouleversé. »
Profil de l’entrepreneuriat dans le Nord
L’analyse des données du sondage quantitative nationale du CSEN de 2024 montre que les entrepreneurs noirs du Nord partagent de nombreux traits avec leurs homologues ailleurs au Canada. Comme dans l’échantillon national, ils sont hautement scolarisés : plus de 90 % possèdent au moins un baccalauréat. Bon nombre mettent leurs compétences à profit dans les services professionnels et techniques ou dans le secteur de la santé et de l’assistance sociale. D’autres se tournent vers le transport et l’entreposage, un secteur qui reflète les réalités de la région. Dans un territoire où les collectivités dépendent du transport régulier des marchandises, investir dans les services liés à la chaîne d’approvisionnement représente à la fois une occasion et une nécessité.
La taille des entreprises reflète également les contraintes de l’économie nordique. La plupart des entreprises noires y sont de petite taille : un quart sont classées comme nanoentreprises et un peu moins d’un cinquième comme microentreprises. Plus de la moitié de ces entreprises dépendent principalement du soutien de la famille et des amis, ce qui met en évidence la disponibilité limitée de réseaux élargis et de soutien institutionnel.
Le manque d’accès au financement ajoute une couche supplémentaire de difficulté. Près de 40 % des entrepreneurs du Nord déclarent ne pas connaître l’existence de programmes spécifiquement conçus pour les propriétaires d’entreprises noirs. Dans les Territoires du Nord-Ouest, cette proportion grimpe à 73 %. Bien que ces pourcentages proviennent d’échantillons de petite taille, ils révèlent une tendance plus générale : les programmes de soutien ne rejoignent pas les entrepreneurs dans plusieurs des régions les plus éloignées du pays, où les possibilités d’entrepreneuriat sont étroitement liées au développement communautaire.
Bâtir la confiance là où elle a été brisée
Mme Hall a constaté que de nombreux entrepreneurs de la région demeuraient sceptiques à l’égard des initiatives externes. « Beaucoup de propriétaires d’entreprises ici sont désabusés, note-t-elle. Les organisations viennent dans le Nord pour recueillir de l’information, promettent du soutien, puis disparaissent. Ce passé rend la construction de la confiance plus difficile. »
Dans les grands centres urbains, les entrepreneurs se tournent souvent vers les plateformes numériques pour élargir leur clientèle. Dans le Nord, les entreprises reposent beaucoup plus sur les liens de proximité. « Ici, il existe un esprit de voisinage, explique Mme Hall. Les gens connaissent leurs voisins, s’entraident et font avancer les affaires par le bouche-à-oreille plutôt que par des campagnes sur les médias sociaux. C’est une force, mais cela signifie aussi que les structures de soutien qui fonctionnent dans les grandes villes ne s’appliquent pas toujours ici. »
Grâce au carrefour régional nord du CSEN, Mme Hall et ses collègues de l’UNBC ont entrepris de combler ces écarts. Leurs efforts comprenaient des activités de sensibilisation en personne, des partenariats avec des établissements comme l’Université du Yukon et le lancement du programme de mentorat et de bourses Magnifying Black Voices. Conçu pour les étudiants noirs, tant canadiens qu’internationaux, ce programme combine un soutien financier et du mentorat afin de créer un bassin de talents pour les futurs entrepreneurs noirs.
Plus récemment, en mars, le carrefour nordique de l’UNBC a organisé une table ronde régionale sur l’avenir inclusif de l’entrepreneuriat, qui a servi de base à l’élaboration d’une stratégie d’entrepreneuriat adaptée au Nord. Comme l’a indiqué Richard McAloney, actuel coordonnateur du carrefour : « Le rôle de carrefour régional nord du CSEN a donné l’élan nécessaire à la prochaine étape du développement de l’écosystème entrepreneurial dans le Nord. »
L’UNBC dirigera la Stratégie nationale i2I (Invention to Innovation) pour le Nord, en partenariat avec d’autres acteurs. « Cette stratégie intégrera les recherches fondamentales du CSEN afin de garantir que l’écosystème réponde aux besoins du Nord », poursuit M. McAloney. Le programme vise à combler l’écart entre la recherche et la commercialisation dans les domaines des STIM et de la santé, et à élargir la formation en entrepreneuriat à l’ensemble de la région.
Leçons du Nord
Mme Hall estime que la ténacité des entrepreneurs noirs du Nord offre des leçons pour l’ensemble du pays. « Malgré les obstacles, ces entreprises continuent d’exister, de s’adapter et de prospérer, dit-elle. Cette résilience et cette créativité sont des forces dont le Canada peut s’inspirer. Mais pour les valoriser, nous devons nous assurer que le Nord n’est pas traité comme une simple réflexion secondaire. »
Le coût de la distance est bien réel. Il se mesure dans les écarts de financement, dans le choix des secteurs d’activité et dans l’importance accordée aux liens communautaires. Pourtant, les entrepreneurs noirs du Nord continuent de bâtir, en s’appuyant sur leur communauté tout en réclamant des liens plus solides avec le reste du pays.
Le carrefour nordique du CSEN travaille à faire en sorte que ces voix ne se perdent pas dans la distance, mais qu’elles soient appuyées par des mesures adaptées aux réalités de la région.